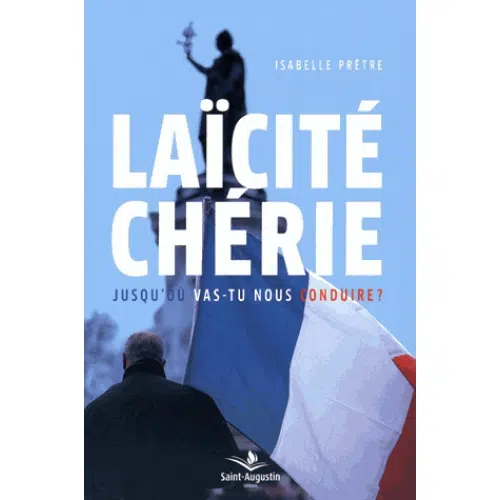Un chiffre froid, une règle stricte : dans la fonction publique, le premier jour d’arrêt maladie rime avec absence de salaire. Ici, pas de distinction entre les grades, ni de traitement de faveur. La suspension de la rémunération s’impose dès le début, sauf si la maladie découle directement de l’exercice du métier ou d’un accident en service. Certaines situations font exception, comme la maternité ou une affection grave reconnue. Le couperet du jour de carence ne fait pas la différence entre titulaire et contractuel : chacun y est soumis, peu importe son parcours.
Ce retour de la journée de carence, décidé en 2018 après une période sans, continue d’alimenter les discussions. L’application exacte du dispositif, ses variantes selon les employeurs ou les contrats, soulèvent régulièrement des doutes. Mais pour tous les agents concernés, la question qui demeure : quel impact sur le portefeuille ?
Jour de carence dans la fonction publique : de quoi parle-t-on vraiment ?
Le jour de carence dans la fonction publique, c’est le premier jour d’arrêt maladie non payé, appliqué à chaque arrêt. Que l’on soit fonctionnaire chevronné ou contractuel tout juste embauché, la règle s’abat sans distinction : quand l’arrêt maladie tombe, le congé de maladie débute, mais aucune rémunération ne tombe pour ces premières 24 heures.
Chaque nouvel arrêt maladie déclenche ce mécanisme, sauf rares exceptions précisées dans la réglementation : le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), la longue maladie ou une affection de longue durée (ALD) en font partie. Pour une ALD, la règle n’est appliquée qu’une fois sur trois ans, même si la pathologie justifie plusieurs absences.
Quelques points à retenir pour cerner qui est concerné et comment s’organisent les démarches :
- Tous les agents publics, qu’ils soient en poste ou en détachement, relèvent du jour de carence.
- Un arrêt de travail établi par un professionnel de santé reste indispensable à toute demande de congé maladie.
- En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le traitement indiciaire demeure intégralement payé dès le premier jour d’absence.
Le dispositif cherche à rapprocher public et privé, sans pour autant supprimer les spécificités de la fonction publique. Les exceptions perdurent, notamment pour les agents particulièrement exposés ou confrontés à des situations comme une maternité, une fausse couche ou la perte d’un enfant. Naviguer dans le maquis du congé maladie public reste souvent complexe.
Qui est concerné par le jour de carence et dans quelles situations s’applique-t-il ?
Peu importe qu’on soit fonctionnaire ou contractuel : dès l’arrêt pour maladie ordinaire, le jour de carence s’applique. L’ancienneté ne pèse pas, le statut non plus. Ce n’est pourtant pas une règle à sens unique : des situations particulières évitent la retenue.
Voici dans quels cas la retenue du jour de carence ne s’applique pas :
- Aucune retenue lors d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), d’accident de service ou de maladie professionnelle.
- Les congés de longue maladie et de longue durée échappent eux aussi à cette règle.
- Pour une affection de longue durée (ALD), la retenue ne frappe qu’une seule fois sur trois ans pour la même maladie, quel que soit le nombre d’arrêts.
- Pas de jour de carence pour les arrêts liés à la maternité, à la grossesse pathologique, au congé maternité, à une interruption médicale de grossesse ou au décès d’un enfant.
Chaque situation doit être justifiée par un certificat médical. À chaque nouvel arrêt, le jour de carence est appliqué si aucune dérogation légale ne s’y oppose. Ce modèle hérité du secteur privé soulève le débat : faut-il tout sacrifier à la gestion budgétaire ou adapter ces dispositifs aux réalités du service public ?
Conséquences financières : ce que le jour de carence change pour votre rémunération
L’application du jour de carence se traduit par une retenue immédiate sur la rémunération des agents. Plutôt que des chiffres abstraits, prenons un exemple concret : un agent absent pour cause de maladie ordinaire ne perçoit rien le premier jour. Non seulement le traitement indiciaire brut disparaît, mais aussi les primes, indemnité de résidence, supplément familial de traitement (SFT) et nouvelle bonification indiciaire (NBI), tout s’évapore pour cette journée.
Dès le deuxième jour d’arrêt, le salaire redevient normal. L’ancienneté n’entre pas en jeu pour cette première journée sans solde. Pour les contractuels, la protection évolue après ce délai : plus le temps passé dans la fonction publique est élevé, plus la durée de maintien de la rémunération augmente lors d’un arrêt maladie.
Les arrêts pour accident de service ou maladie professionnelle dérogent : la rémunération, y compris les compléments, est maintenue dès le départ, sans interruption. Les agents contractuels touchent les indemnités journalières de la Sécurité sociale à partir du quatrième jour d’arrêt maladie, après trois jours de carence s’appliquant selon le droit commun.
| Situation | Jour de carence appliqué ? | Rémunération perdue |
|---|---|---|
| Maladie ordinaire | Oui | Traitement indiciaire, primes, SFT, NBI, indemnité de résidence |
| Accident de service / Maladie professionnelle | Non | Aucune |
Concrètement, un arrêt maladie ordinaire entraîne une journée blanche sur la fiche de paie : aucun salaire, aucune prime, aucune indemnité pour cette date précise. Le rappel constant que la règle frappe sans nuances, à chaque nouvel arrêt pour maladie dite « ordinaire ».
Ressources et démarches pour mieux comprendre ou contester l’application du jour de carence
Le jour de carence s’applique dès lors qu’un arrêt de travail est fourni par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme. Ce justificatif doit parvenir à l’administration employeur sous 48 heures. Respecter ce délai garantit le bon traitement du dossier, ainsi que la prise en compte des droits. Si l’agent est hospitalisé, ce délai devient plus souple, à condition de fournir rapidement une explication.
Un arrêt transmis au-delà des 48 heures fait l’objet d’une notification. Répéter ce retard dans les deux ans suivants entraîne une retenue sur salaire, qui s’ajoute au jour de carence déjà appliqué. Ce système responsabilise chaque agent et vise à traiter tous les cas sur un pied d’égalité.
Pour contester la retenue du jour de carence, plusieurs situations sont recevables, à condition d’en fournir la preuve. Voici dans quels cas un recours peut être envisagé :
- maladie professionnelle ou accident de service,
- affection de longue durée reconnue,
- congé maternité ou pathologie liée à la grossesse,
- fausse couche avant la 22e semaine,
- invalidité temporaire reconnue comme imputable au service.
La première étape consiste à déposer une demande auprès des ressources humaines, en transmettant l’intégralité des pièces justificatives. Si le désaccord persiste, la commission administrative paritaire peut être saisie : elle étudiera le dossier et donnera sa décision.
Qu’on s’y résigne ou qu’on la conteste, la journée de carence garde une réputation de coupure nette : dans la vie d’un agent public, ce n’est ni un détail, ni une formalité oubliable. À chaque absence, la règle se rappelle, inflexible. Mais demain, ce dispositif restera-t-il figé ou connaîtra-t-il, à son tour, son jour de bascule ?