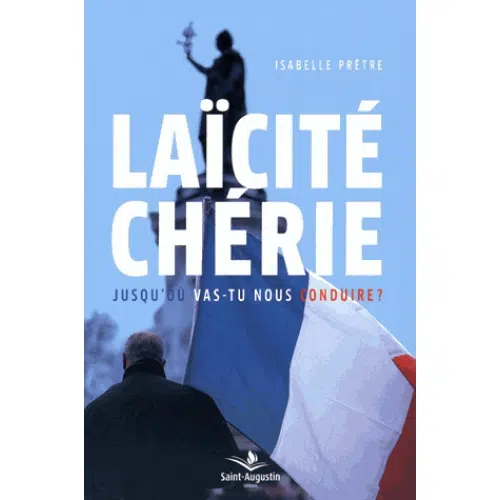Les statistiques ne mentent pas : les conséquences d’un traumatisme ne s’arrêtent pas à la génération qui l’a enduré. Au Canada, la Commission de vérité et réconciliation a reconnu l’impact des pensionnats sur les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des survivants. Selon l’OMS, certains troubles de santé mentale se transmettent plus fréquemment dans les familles exposées à des violences historiques ou à des catastrophes collectives.
Des travaux menés en épigénétique montrent que des événements traumatiques vécus par une génération peuvent modifier l’expression de certains gènes chez leurs descendants. Ces constats bousculent l’idée que les blessures psychiques s’effacent avec le temps ou le changement de contexte.
Traumatisme générationnel : comprendre un héritage invisible
Ce qui se transmet de génération en génération n’est pas toujours visible, ni même raconté à voix haute. Le traumatisme générationnel façonne des histoires de famille, mais aussi des silences, des absences et des attitudes qui se répètent sans explication claire. Derrière les mots « traumatisme transgénérationnel » ou « traumatisme intergénérationnel », les chercheurs désignent ces blessures psychiques qui circulent de parents à enfants, souvent à l’insu de tous. L’ADN n’est pas la seule voie de passage : la douleur s’infiltre aussi dans les choix de vie, les gestes du quotidien, les secrets gardés, les ruptures ou les silences qui pèsent à table.
Chez les descendants de survivants de la Shoah, la recherche s’est penchée sur l’impact du trauma familial. Enfants comme petits-enfants héritent d’une mémoire marquée par les zones d’ombre, la culpabilité qui colle à la peau, l’angoisse persistante. D’autres études, menées sur les familles touchées par la Seconde Guerre mondiale ou sur les survivants des pensionnats autochtones au Canada, décrivent les mêmes symptômes : anxiété, difficulté à gérer le stress, troubles identitaires parfois profonds.
L’ombre du passé plane également sur les familles frappées par l’inceste, la violence ou l’exil. Ici encore, les traumatismes intergénérationnels s’observent à travers la répétition de schémas relationnels ou de difficultés émotionnelles qui ne trouvent pas d’explication dans la seule histoire personnelle. Aujourd’hui, la psychologie, la psychanalyse, mais aussi la génétique et l’épigénétique, dénouent peu à peu les fils de cet héritage longtemps confondu avec une fatalité impossible à nommer.
Qui est concerné par la transmission des traumatismes au sein des familles ?
La transmission des traumatismes au sein de la famille ne s’arrête pas à la première génération. Les enfants de ceux qui ont vécu des épreuves extrêmes, comme les descendants de survivants de la Shoah ou de la Seconde Guerre mondiale, portent souvent des traces invisibles : anxiété latente, difficulté à trouver leur place, troubles du sommeil qui résistent à toute explication rationnelle. Rien ne saute aux yeux, tout se transmet dans l’ombre.
La génération suivante, celle des petits-enfants, ne sort pas indemne de cette histoire silencieuse. Là où le silence a été la règle, les non-dits se transforment en héritage. Mais le phénomène ne s’arrête pas aux frontières de la famille. Il touche aussi les communautés minoritaires marquées par la guerre, l’exil ou la persécution. Chez les descendants de réfugiés ou de migrants, la mémoire se fait poids quotidien, même si les mots manquent pour l’exprimer.
Dans les familles confrontées à l’inceste, à la violence ou à la stigmatisation, la transmission transgénérationnelle du traumatisme adopte des formes variées : comportements répétitifs, peurs sans cause apparente, sentiment persistant de ne pas être à sa place. Malgré l’avancée de la recherche, le sujet reste délicat, souvent tabou. Psychologues et cliniciens le rappellent : aucun milieu social, aucune origine n’est à l’abri. Les cicatrices du passé s’invitent dans la vie des générations suivantes, que la blessure relève d’un drame collectif ou d’une histoire familiale restée dans l’ombre.
Des mécanismes complexes : comment les blessures du passé se perpétuent-elles ?
Transmettre un traumatisme transgénérationnel, ce n’est pas inscrire une trace à l’encre indélébile, mais diffuser une empreinte subtile, souvent inconsciente. Les chercheurs identifient plusieurs mécanismes à l’œuvre.
La biologie, d’abord : les équipes de Rachel Yehuda, Isabelle Mansuy ou Moshe Szyf ont montré que le trauma laisse sa marque sur les gènes par le biais de modifications épigénétiques. La méthylation de l’ADN modifie l’expression des gènes sans toucher à la séquence elle-même. Chez les descendants de survivants de la Shoah, par exemple, ces traces épigénétiques modulent la réaction au stress, génération après génération.
Mais l’explication ne s’arrête pas au laboratoire. L’environnement familial joue un rôle tout aussi déterminant. Voici les principaux vecteurs de transmission repérés par les spécialistes :
- Secrets de famille
- non-dits
- répétition de schémas comportementaux
- exposition précoce à la peur ou à la violence
Dans ce contexte, les neurones miroirs entrent en scène : l’enfant absorbe, sans même s’en rendre compte, les attitudes de ses parents imprégnés d’un stress chronique ou d’une hypervigilance héritée.
Des expériences menées par Brian Dias sur des souris ont mis en lumière la puissance de la transmission épigénétique : une simple association entre une odeur et une décharge électrique suffit à déclencher, chez les petits, une réaction de peur à cette même odeur. Ici, la transmission ne relève ni du mythe ni d’un simple récit. Biologie, psychologie et environnement social s’entremêlent, dessinant un réseau complexe qui relie les générations entre elles.
Répercussions sur les générations futures et pistes pour s’en libérer
L’empreinte des traumatismes transgénérationnels se lit dans le quotidien des générations qui suivent. Les signes sont multiples : anxiété diffuse, insomnies, hypervigilance, difficultés à tisser des liens. Chez les descendants de survivants de la Shoah, plusieurs études font état d’une fréquence accrue de troubles liés au stress post-traumatique (SSPT), souvent accompagnés d’une estime de soi fragile ou d’un sentiment d’insécurité tenace. Même loin de l’événement d’origine, la santé mentale des enfants et petits-enfants reste marquée, preuve de la puissance de la transmission familiale.
Pour sortir de cette spirale, plusieurs pistes s’ouvrent. La psychothérapie figure en bonne place. Certaines méthodes, comme la thérapie EMDR, validée par l’American Psychological Association, ou la thérapie familiale, ciblent directement les séquelles du traumatisme. Les outils de la psychanalyse transgénérationnelle, tels que le génogramme ou l’arbre généalogique, aident à éclairer les transmissions invisibles et à dénouer les répétitions familiales.
Renforcer la qualité des liens et enrichir les échanges intergénérationnels contribuent également à atténuer l’impact du traumatisme. La résilience prend forme quand la parole circule, quand le silence se rompt et que l’histoire familiale retrouve sa continuité.
À chaque génération, un choix : celui de regarder le passé en face, d’oser rompre la chaîne du silence. Le chemin est long, mais il commence souvent par un premier mot prononcé à voix haute.